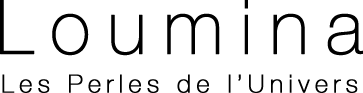Le genre policier a donné naissance à une multitude de sous-genres, parmi lesquels le « whodunit » occupe une place emblématique. Abréviation de l’expression anglaise « Who [has] done it? », ce terme désigne une forme particulière de roman d’enquête centré sur la résolution d’un mystère criminel, généralement un meurtre, par la découverte de l’identité du coupable. Le lecteur, mis au défi par l’auteur, devient lui-même détective au fil des pages. À travers cet article, nous explorerons les origines du whodunit, ses caractéristiques essentielles, les types de récits qu’il englobe, ainsi que des exemples notables. Nous conclurons par une réflexion sur l’appartenance du célèbre Sherlock Holmes à ce genre.
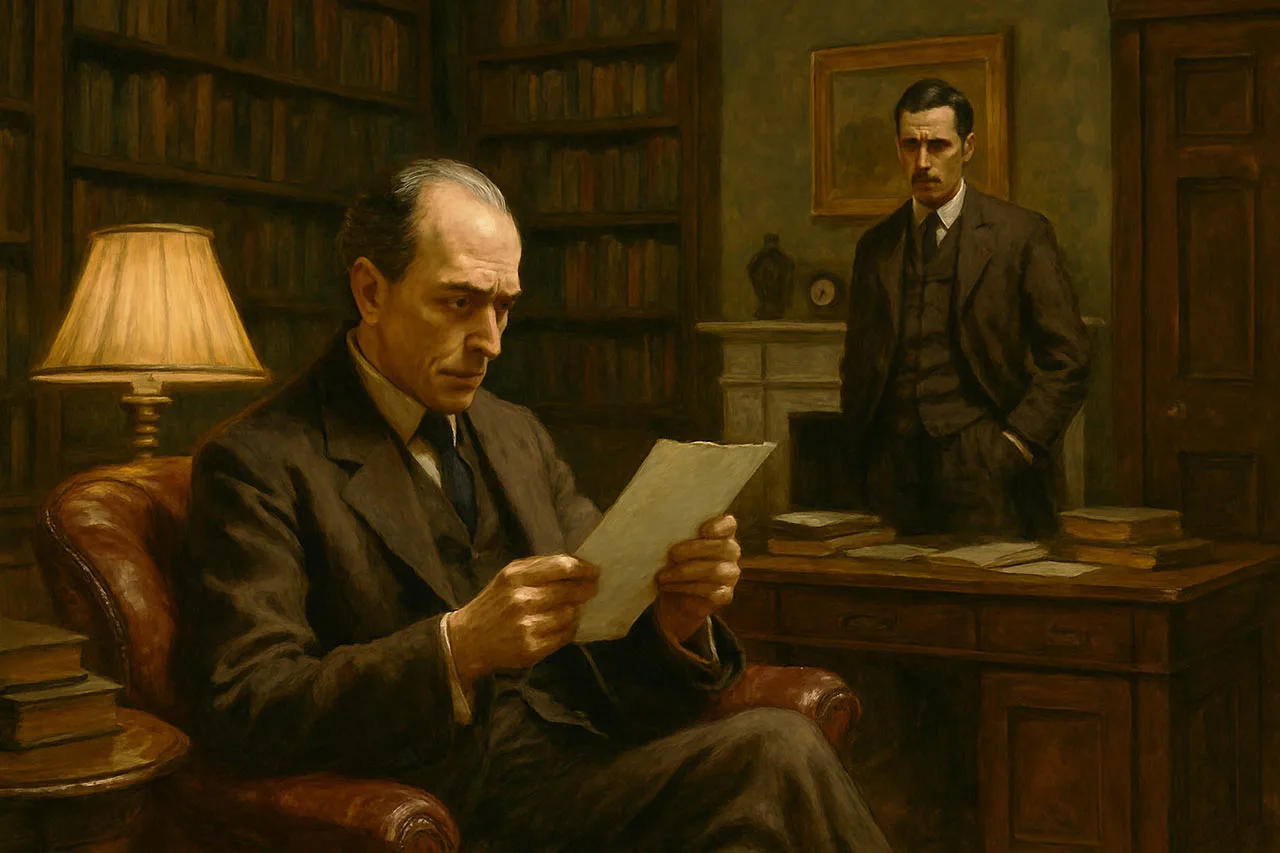
Les origines du whodunit
Le whodunit trouve ses racines dans la littérature policière du XIXe siècle. Si l’on attribue souvent la création du roman policier à Edgar Allan Poe avec Les crimes de la rue Morgue (1841), c’est au début du XXe siècle que le whodunit se définit en tant que genre à part entière. Il connaît son apogée durant l’âge d’or du roman policier anglais, entre les années 1920 et 1940. Cette période est marquée par l’œuvre d’auteurs emblématiques tels qu’Agatha Christie, Dorothy L. Sayers ou encore G.K. Chesterton.
La montée en popularité du whodunit coïncide avec un changement dans les attentes du lectorat. Plutôt que des poursuites haletantes ou une violence spectaculaire, le public apprécie la subtilité d’une intrigue bien construite, la logique implacable d’une déduction, et la satisfaction intellectuelle que procure la résolution d’une énigme.
Les caractéristiques du whodunit
Le whodunit suit généralement une structure narrative rigoureuse. Un crime, souvent un meurtre, survient dans un cadre délimité (manoir, village, train, etc.). Un ensemble de suspects présentant chacun des mobiles et des opportunités est introduit. L’enquêteur, amateur ou professionnel, collecte les indices, interroge les suspects, et, par un raisonnement logique, identifie le coupable lors d’une révélation finale spectaculaire.
Le style du whodunit est souvent clair, dépourvu d’effets lyriques inutiles, et axé sur les faits. Le récit peut être narré à la première ou à la troisième personne, et l’auteur joue un jeu délicat avec le lecteur, en dissimulant des indices tout en les plaçant à la vue de tous.
Types d’histoires et variantes du whodunit
Il existe plusieurs formes de whodunit :
- Le roman à « chambre close » : où le crime semble impossible (par exemple, commis dans une pièce verrouillée de l’intérieur). John Dickson Carr en est un maître incontesté.
- Le whodunit psychologique : où l’accent est mis sur les motivations intimes des personnages. Patricia Highsmith a même inversé le dispositif en rendant le coupable connu dès le début.
- Le pastiche ou le méta-whodunit : qui joue avec les codes du genre, comme dans Le Nom de la rose d’Umberto Eco.
Exemples emblématiques de whodunit
- Le Meurtre de Roger Ackroyd (1926) d’Agatha Christie : chef-d’œuvre du genre, ce roman surprend par son narrateur peu fiable. La structure narrative y est manipulée de façon à dérouter le lecteur tout en respectant les règles du fair-play.
- Dix Petits Nègres (1939), aussi publié sous le titre Ils étaient dix : ce roman est un cas particulier de whodunit sans détective, où les protagonistes sont piégés sur une île et tués l’un après l’autre selon une comptine macabre. L’identité du meurtrier reste mystérieuse jusqu’à la fin, et la construction narrative en huis clos renforce le sentiment de paranoïa.
- Le Crime de l’Orient-Express (1934) : un autre classique d’Agatha Christie, mettant en scène Hercule Poirot. Le roman brouille les pistes en introduisant un mobile collectif et une résolution étonnante qui interroge la notion de justice.
- Le Mystère de la chambre jaune (1907) de Gaston Leroux : un modèle du roman à chambre close, où le journaliste-détective Rouletabille fait preuve d’une logique implacable. L’énigme semble insoluble jusqu’à une explication finale qui démontre la maîtrise des rouages du whodunit.
- Les Enquêtes du Padre Brown (1911-1935) de G.K. Chesterton : ces nouvelles mettent en scène un prêtre détective dont l’approche mêle intuition, foi et psychologie humaine. Le whodunit y prend une tournure morale et philosophique.
- La Maison où je suis mort autrefois (1994) de Keigo Higashino : un exemple contemporain de whodunit japonais, mêlant souvenirs enfouis, manipulation mentale et révélation finale déroutante.
- Le Nom de la rose (1980) d’Umberto Eco : à la frontière du whodunit et du roman historique, cette œuvre complexe rend hommage à Sherlock Holmes tout en offrant une méta-réflexion sur les signes, les textes et l’interprétation.

Ces exemples montrent la diversité du whodunit, capable de se réinventer selon les époques, les cultures et les dispositifs narratifs. Des auteurs comme Anthony Horowitz, Sophie Hannah ou encore Ragnar Jónasson contribuent aujourd’hui à prolonger cette tradition en la renouvelant.
Les whodunit contemporains
Le whodunit contemporain connaît un renouveau porté par de nouveaux auteurs et des supports variés. Anthony Horowitz, avec ses romans tels que La Maison de soie ou Magpie Murders, joue habilement avec les codes classiques tout en leur insufflant une modernité narrative. Sophie Hannah, choisie pour prolonger les enquêtes d’Hercule Poirot avec l’accord des ayants droit d’Agatha Christie, propose des intrigues complexes et actuelles.
Par ailleurs, la littérature nordique, avec des auteurs comme Ragnar Jónasson (série Dark Iceland) ou Camilla Läckberg, renouvelle le genre en l’ancrant dans des contextes sociaux contemporains, où la psychologie des personnages joue un rôle central. Le whodunit s’invite également dans les séries télévisées et les formats hybrides, à l’image de Only Murders in the Building ou de À couteaux tirés de Rian Johnson, qui redonnent ses lettres de noblesse au genre sur le petit et grand écran.
Ces œuvres contemporaines témoignent de la vitalité du whodunit, capable de s’adapter aux préoccupations modernes tout en conservant sa structure essentielle fondée sur l’énigme, le suspense et la révélation finale.
Sherlock Holmes est-il un personnage de whodunit ?
Le personnage créé par Arthur Conan Doyle incarne le détective rationnel et méthodique, dont la réputation repose sur une aptitude remarquable à déduire la vérité à partir d’observations apparemment insignifiantes. De prime abord, tout semble le rattacher au whodunit. Pourtant, une analyse approfondie permet de nuancer cette affiliation.
Bien que l’on classe souvent Sherlock Holmes parmi les figures emblématiques du whodunit, certains spécialistes considèrent que ses aventures relèvent davantage du roman d’énigme que du pur whodunit. En effet, dans plusieurs récits de Conan Doyle, l’identité du coupable est connue relativement tôt, et l’enjeu repose plutôt sur la manière dont Holmes parvient à démontrer sa culpabilité. Le plaisir de lecture ne vient pas tant de la découverte du « qui » (who), mais du « comment » (how) et du « pourquoi » (why).
Par exemple, dans Le Chien des Baskerville, l’ambiance gothique et l’élaboration de l’atmosphère priment sur le dévoilement progressif des suspects. De même, dans Une étude en rouge, la narration bifurquée et le récit à rebours éloignent l’intrigue d’une structure classique de whodunit.
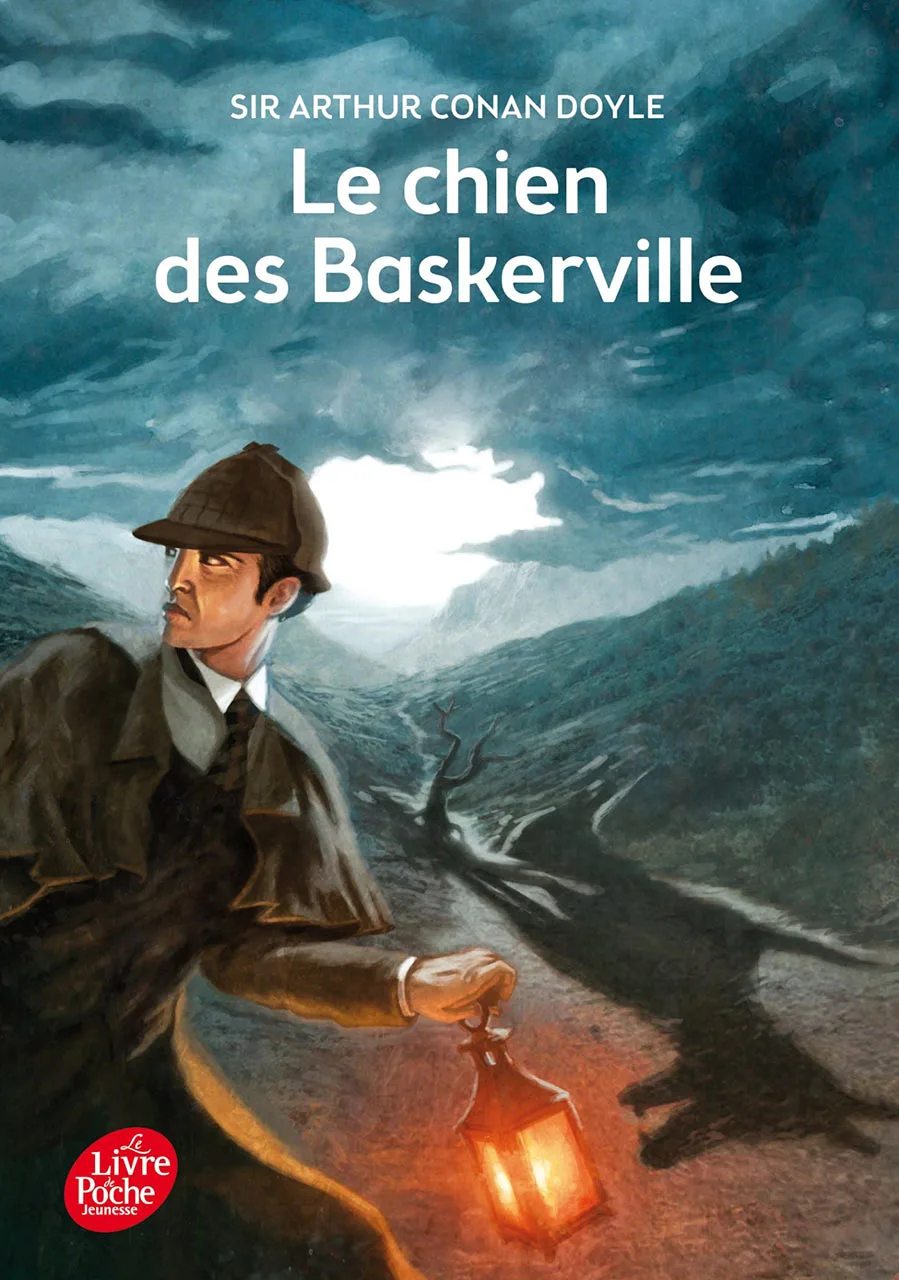
Cependant, certains récits, comme Le Signe des Quatre ou Le mystère de la Vallée de Boscombe, adoptent une construction plus typique du whodunit, avec une énigme centrale, des suspects multiples et une révélation finale.
Il faut donc distinguer deux usages : Sherlock Holmes a influencé les auteurs de whodunit et en partage plusieurs mécanismes (rationalité, confrontation finale, indices), mais son univers littéraire est plus vaste que le seul cadre du whodunit. Il en est une préfiguration, un modèle partiellement conforme.
Un genre intellectuel et ludique
Le whodunit, genre à la fois intellectuel et ludique, continue d’inspirer la littérature contemporaine comme les séries télévisées. Son art de dérouter pour mieux révéler, de jouer avec les apparences pour aboutir à la vérité, en fait un exercice de style à part entière. Si Sherlock Holmes n’en est pas l’incarnation la plus pure, il n’en demeure pas moins une figure fondatrice dont l’ombre plane sur tout le genre. Le whodunit est ainsi moins une formule stricte qu’une tradition en évolution, nourrie par ses racines et renouvelée par ses variations.