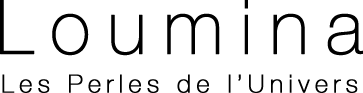Longtemps appelés « nègres littéraires », les prête-plumes – ou écrivains fantômes (ghostwriters en anglais) – sont ceux qui écrivent à la place d’autrui. Biographies, discours politiques, romans, essais ou livres pratiques : ils façonnent les mots des autres tout en restant dans l’ombre. Mais qui sont-ils vraiment ? Pourquoi faire appel à leurs services ? Et comment, aujourd’hui, devenir ghostwriter professionnel ?

Qu’est-ce qu’un prête-plume ou écrivain fantôme ?
Un prête-plume est une personne qui rédige un texte au nom d’un autre, sans en être officiellement l’auteur. Son travail consiste à capter la voix, les idées et le style de son client pour les transformer en un récit fluide, captivant et fidèle.
L’écrivain fantôme intervient dans de nombreux domaines :
- Autobiographies et mémoires de célébrités ou d’anonymes ;
- Discours politiques ou d’entreprise ;
- Romans et essais signés par d’autres ;
- Livres pratiques, guides et contenus professionnels.
Contrairement à l’auteur traditionnel, il ne signe pas son texte. Il peut parfois être mentionné en co-auteur ou dans les remerciements, mais reste souvent invisible. Ce métier exige donc autant de talent littéraire que de discrétion.
Une histoire ancienne : des nègres littéraires aux ghostwriters
Si le terme « ghostwriter » est relativement moderne, le métier, lui, remonte à l’Antiquité.
Des scribes antiques aux secrétaires des rois
Dans l’Égypte et la Mésopotamie antiques, les scribes mettaient par écrit les paroles des souverains ou des sages. Dans la Rome antique, nombre de discours politiques étaient rédigés par des assistants lettrés. L’auteur visible n’était pas toujours l’écrivain réel.
Du siècle classique à Dumas
Au XVIIe siècle, certains historiens avancent que Corneille aurait participé à l’écriture de pièces attribuées à Molière. Au XIXe, Alexandre Dumas, auteur des Trois Mousquetaires, travaillait avec une véritable « fabrique littéraire », dont Auguste Maquet fut l’un des principaux artisans. Il fut même surnommé son « nègre », un mot alors courant pour désigner ces écrivains invisibles.
Le XXe siècle et la professionnalisation
Au XXe siècle, la pratique se démocratise. Des écrivains célèbres comme André Maurois, Paul Morand ou Georges Simenon écrivent pour d’autres. Le terme « nègre littéraire » devient courant dans l’édition française, avant d’être progressivement abandonné à cause de sa connotation raciste. Aujourd’hui, on parle surtout de prête-plume, collaborateur littéraire ou ghostwriter.
Pourquoi faire appel à un écrivain fantôme ?
Recourir à un prête-plume n’est ni une tricherie ni une exception. Au contraire, c’est une pratique fréquente et souvent essentielle pour donner naissance à certains textes. Voici les principales raisons.
1. Raconter une histoire forte sans maîtriser l’écriture
Tout le monde n’a pas le talent ou l’expérience nécessaires pour structurer un récit. Le ghostwriter met alors ses compétences au service d’un projet personnel : mémoires familiales, autobiographie, témoignage…
2. Gagner du temps
Écrire un livre demande des mois de travail. Les dirigeants, politiques, sportifs ou entrepreneurs préfèrent confier cette mission à un professionnel pour se concentrer sur leurs activités principales.
3. Valoriser son image et sa stratégie
Un livre peut renforcer une marque personnelle ou une carrière. Publier un essai sur sa vision ou un récit de parcours professionnel peut devenir un levier d’autorité. Dans ce cas, l’écrivain fantôme devient un partenaire stratégique.
4. Obtenir un résultat professionnel
L’écriture ne consiste pas seulement à « mettre des mots sur du papier » : il s’agit de structurer, raconter, captiver. Un ghostwriter garantit un livre bien écrit, lisible et efficace, fidèle à la voix de son client.
Les compétences clés d’un prête-plume
Devenir écrivain fantôme ne consiste pas seulement à bien écrire. C’est un métier complet, qui demande des compétences humaines, littéraires et techniques.
1. L’écoute active
Tout projet commence par des entretiens approfondis. Le prête-plume doit comprendre l’histoire, la personnalité et la manière de s’exprimer de son client. Il capte des détails, des tics de langage, des émotions, tout ce qui rendra l’écriture authentique.
2. L’art du mimétisme stylistique
Le ghostwriter doit être capable d’écrire dans la voix d’un autre. Cela signifie adapter son style, sa syntaxe, son vocabulaire. Il devient une sorte de comédien de l’écriture, capable d’endosser une voix différente de la sienne.
3. La rigueur narrative
Il ne suffit pas de retranscrire des souvenirs : il faut les organiser, les structurer, créer un fil conducteur. L’écrivain fantôme est aussi un architecte du récit.
4. La discrétion et l’éthique
La confidentialité est essentielle. Un ghostwriter ne divulgue jamais les détails d’un projet, ni l’identité de ses clients. La confiance est la base de la relation.
Comment devenir prête-plume : guide pratique
Il n’existe pas de parcours unique pour exercer ce métier. Certains ghostwriters viennent du journalisme, d’autres de la littérature, de l’édition ou du marketing. Voici les étapes pour se lancer.
1. Maîtriser l’art d’écrire
Lire, écrire, réécrire. Explorer des styles différents. S’entraîner à rédiger des biographies fictives, des articles, des récits à la première personne. La polyvalence est cruciale.
2. Se former à l’entretien
Apprendre à poser des questions ouvertes, à écouter activement, à creuser les non-dits. L’entretien est souvent l’étape la plus importante de tout projet.
3. Construire un portfolio
Même si le ghostwriting implique souvent l’anonymat, vous pouvez présenter des échantillons fictifs ou anonymisés de votre travail, ou publier vos propres textes pour montrer votre style.
4. Trouver ses premiers clients
- Proposer vos services sur des plateformes de rédaction ou des sites de freelances ;
- Contacter des maisons d’édition qui sous-traitent des projets ;
- Approcher des entrepreneurs, influenceurs ou personnalités susceptibles de vouloir publier.
5. Négocier contrat et droits
Un contrat clair protège les deux parties. Il doit préciser :
- Le niveau d’anonymat (mention ou non de votre nom) ;
- Les droits d’auteur (paiement unique ou pourcentage) ;
- Les délais et conditions de confidentialité.
Un métier en pleine expansion
Avec l’explosion du personal branding, du contenu éditorial et des publications en autoédition, la demande pour les écrivains fantômes explose.
- De plus en plus de chefs d’entreprise publient leurs visions stratégiques.
- Les influenceurs veulent raconter leur parcours.
- Les célébrités publient des autobiographies chaque année.
Résultat : le métier de ghostwriter s’est professionnalisé. Certains travaillent pour des agences, d’autres en indépendant. Certains revendiquent leur rôle en apparaissant en co-auteur, d’autres cultivent l’anonymat total.
L’éthique du ghostwriting : tricherie ou art littéraire ?
Le ghostwriting suscite parfois la controverse : est-il légitime de signer un texte qu’on n’a pas écrit ? La question est complexe.
En réalité, l’écriture a toujours été un travail collectif : éditeurs, correcteurs de manuscrits, conseillers éditoriaux participent tous à l’élaboration d’un livre. Le prête-plume n’est pas un imposteur, mais un interprète. Il donne forme à une idée sans se l’approprier.
Dans de nombreux cas, il rend possible l’expression de voix qui, sans lui, resteraient silencieuses. C’est particulièrement vrai pour les récits de survivants, les témoignages historiques ou les autobiographies d’anonymes.
Être l’ombre qui éclaire
Être prête-plume, c’est accepter de disparaître pour mieux faire exister l’autre. C’est écouter profondément, comprendre intimement, et écrire comme si l’on était quelqu’un d’autre. C’est une forme d’altruisme littéraire, mais aussi un métier exigeant et passionnant.
Dans un monde saturé de contenus, les ghostwriters sont les architectes invisibles de nombreuses histoires. Sans eux, bien des voix resteraient muettes. Et c’est peut-être cela, la plus belle définition du métier : écrire pour faire exister.
Écrire pour exister… ou pour faire exister
Devenir prête-plume, c’est se tenir à la croisée de l’art et du service. C’est savoir manier les mots pour raconter les histoires des autres, tout en acceptant de ne pas en tirer la gloire. Mais c’est aussi une façon unique d’explorer la condition humaine, de multiplier les points de vue, de traverser des vies par procuration.
À l’heure où chacun veut raconter sa version du monde, les ghostwriters sont plus nécessaires que jamais. Invisibles, discrets, mais essentiels, ils rappellent une vérité ancienne : ce qui compte, ce ne sont pas les noms sur les couvertures, mais les histoires qui restent.