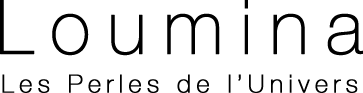C’est le genre de livre qu’on lit d’un œil, l’autre surveillant les enfants qui barbotent dans la mer. Un roman qui rassure plus qu’il ne questionne, qui apaise plutôt qu’il ne dérange. Mais le feel-good est-il un baume pour l’âme – ou un signe de déclin culturel ?
Des kiosques d’aéroport aux listes de best-sellers estivales, les romans feel-good ont envahi le paysage littéraire contemporain. Couvertures pastel, prose légère, promesse d’une fin heureuse. Ils sont l’équivalent littéraire d’une tisane chaude ou d’une étreinte après une mauvaise journée. Et quoi de mal à cela – vraiment ?
Cette tendance croissante de la « littérature confortable » n’échappe pas aux critiques. Certains y voient une dérive : une littérature qui préfère rassurer plutôt que bousculer, qui mise sur la facilité au détriment de la profondeur. Une sorte de sucette littéraire qui apaise, mais n’éveille plus.

Un genre qui ne veut pas faire mal
Le roman feel-good se définit par sa sécurité émotionnelle. Ce sont des histoires de rédemption, de hasards heureux, de blessures intérieures doucement réparées. Une veuve hérite d’un cottage en bord de mer, un vieux grincheux réapprend à aimer, des âmes perdues se reconstruisent grâce au charme d’un village ou d’une librairie un peu bohème.
Les conflits ne manquent pas, certes, mais leur résolution est prévisible, réconfortante. Le lecteur sait ce qu’il obtiendra : une fin heureuse. Ces romans demandent peu, n’exigent rien, et livrent exactement ce qu’ils annoncent.
Dans un monde perclus d’anxiété, de collapsologie et de chaos géopolitique, qui pourrait reprocher aux lecteurs de chercher un moment de paix ?
Et pourtant, derrière ces couvertures souriantes, une question surgit : que devient la littérature quand elle ne fait plus mal ?
Le nivellement par le bas : quand le livre devient produit
L’édition, comme toute industrie, suit la demande. Après l’essor des fictions introspectives à la Sally Rooney, le marché s’est rué sur la tendance du « feel good ». On publie, on décline, on emballe.
Mais cette vague de romans réconfortants semble particulièrement symptomatique d’un nivellement par le bas : pas nécessairement en qualité littéraire, mais en intensité émotionnelle. Il ne s’agit plus de provoquer, mais d’apaiser.
Dans cette logique, le roman n’est plus un lieu de résistance ou de réflexion ; il devient un produit consommable, jetable, aussitôt lu, aussitôt oublié. Les enjeux ? Faibles. Les ambitions ? Moindres.
On pourrait y voir le reflet d’une société en quête de sécurité émotionnelle. Mais qu’advient-il d’une culture qui ne tolère plus l’inconfort – même dans ses fictions ?
Le prix du confort
La vraie littérature, dans ce qu’elle a de plus grand, nous secoue. Elle interroge l’identité, le passé, le présent, le sens de nos existences. Pensez à Toni Morrison dans Beloved, au désespoir méthodique de Kafka, à la précision émotionnelle d’une Elena Ferrante, à la cruauté nue de Cormac McCarthy, ou encore à la profondeur psychologique de Virginia Woolf.
Ces œuvres nous marquent car elles exigent de nous : notre attention, notre capacité d’empathie, notre endurance émotionnelle.
Le roman feel-good, lui, offre une évasion à bas prix. Il se veut agréable. Mais la littérature doit-elle l’être ? Doit-elle toujours consoler ?
Pour la professeure Anne Roussel, spécialiste de littérature comparée à la Sorbonne, la montée de cette tendance est révélatrice d’un épuisement collectif :
« Les gens n’ont plus l’énergie pour affronter des récits denses. Après une journée passée entre notifications et actualités anxiogènes, ils veulent des histoires qui soignent. Mais guérir, en littérature comme en thérapie, suppose souvent la confrontation – pas l’évitement. »
Investissement émotionnel : les romans qui nous happent
Quand on interroge les lecteurs sur les livres qui les ont réellement transformés, ils ne citent pas ceux qui les ont simplement fait se sentir bien. Ils parlent de ceux qui les ont fait ressentir : douleur, joie, confusion, rage, vertige.
Ces romans ne supportent pas la lecture distraite. Ils s’imposent. Ils vous obligent à poser le livre pour respirer ; mais vous y revenez changé.
Le fameux « bouquin de plage » – souvent synonyme de roman feel-good – suppose un lecteur désengagé, passif, voire distrait par le bruit des vagues et les enfants à surveiller. Mais doit-on abaisser les exigences littéraires sous prétexte de sable chaud ?
Attention, un roman intense n’est pas forcément déprimant. Il peut être lumineux, libérateur. Mais sa lumière est méritée, pas simulée. Prenons Vieux, râleur et suicidaire : La vie selon Ove de Fredrik Backman. L’histoire est touchante, pleine d’humour, mais elle n’élude ni la solitude, ni le deuil, ni les pensées suicidaires. Ou encore La voleuse de livres de Markus Zusak, qui trouve de la beauté au cœur même de l’horreur.
Ce qui différencie ces romans du feel-good formaté, c’est leur vérité émotionnelle. Rien n’y est gratuit. La douleur est réelle, la consolation aussi, mais elle ne triche pas.
Infantilisation du lecteur ?
Certains vont plus loin et dénoncent une infantilisation du lectorat. Les romans feel-good offrent une prévisibilité émotionnelle, une morale simplifiée, des arcs narratifs balisés où tout finit bien, comme un terrain de jeu sécurisé.
À l’inverse, les romans qui abordent l’ambiguïté, le doute moral ou le tragique exigent une maturité. Ils ne promettent pas de clarté. Ils laissent la place à l’inconfort, à la question sans réponse.
En choisissant systématiquement le confort, ne sommes-nous pas en train d’abaisser nos attentes envers nous-mêmes, en tant que lecteurs ? N’est-ce pas dire : « Ne t’inquiète pas, ce livre ne te fera pas trop réfléchir » ?
Quand l’évasion devient évitement
Bien sûr, il n’y a rien de mal à chercher l’évasion. Depuis toujours, les humains racontent des histoires pour se distraire, pour oublier.
Mais quand l’évasion devient notre seule manière d’aborder la littérature, elle cesse d’être un refuge. Elle devient une fuite. Ces romans nous disent que tout ira bien, même quand tout va mal. Ils offrent des fins heureuses dans un monde qui ne les garantit pas.
Comme l’écrit la critique culturelle Zadie Winters : « Le roman feel-good apaise les symptômes mais n’effleure pas la maladie. Il nous rassure sur notre bonté, sur un monde gentil. Mais la littérature n’est pas là pour nous flatter. Elle est là pour nous déranger — ou alors, à quoi bon ? »
Le feel-good : perte de temps ?
Pas forcément. Ils ont leur utilité. Ils réconfortent, parfois même réparent. Ils peuvent être des portes d’entrée vers la lecture pour des publics moins familiers. Mais il faut reconnaître que ce ne sont pas les mêmes livres que ceux qui creusent, qui interrogent, qui transforment.
Lire n’est pas un acte moral. On peut lire pour se sentir mieux. Mais si l’on ne cherche que cela, on ne grandit pas. Ni comme lecteur, ni comme être humain.
Le problème n’est pas le feel-good en soi. Le problème, c’est l’omniprésence. Quand les catalogues éditoriaux penchent presque exclusivement vers la légèreté rassurante, il devient difficile pour les œuvres exigeantes de trouver leur place. On risque de devenir une société qui ne veut plus être bousculée, même en tournant une page.
Une place pour chacun, mais pas à égalité
La littérature devrait être un festin, pas un buffet de desserts. Les romans feel-good ont leur rôle, mais ce n’est pas celui des romans qui explorent la condition humaine dans toute sa complexité.
Aimons les livres qui nous apaisent, oui. Mais n’oublions pas ceux qui nous dérangent, nous écorchent, nous transforment.
Alors, la prochaine fois que vous préparez votre sac de plage, glissez-y votre roman réconfortant – mais pourquoi ne pas y ajouter aussi un texte plus intense ? Un roman qui ne se contente pas de vous faire du bien, mais qui vous fait ressentir, dans toute la gamme du vivant.
C’est cela, surtout, la vraie littérature.