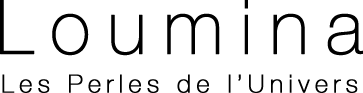Il y a, au moment de commencer un roman, des décisions qui semblent anodines et qui, pourtant, engagent tout le livre. Le choix du narrateur, le point de vue, la voix. Et puis il y a celle-ci, plus sournoise, souvent repoussée à plus tard, parfois tranchée sans y penser vraiment : écrire au présent ou au passé.
Ce dilemme n’est pas qu’une affaire de grammaire. Il touche au souffle du récit, à la façon dont le temps se déploie sur la page, à la relation intime que l’auteur tisse avec son lecteur. Le présent et le passé ne racontent pas la même histoire, même lorsque les événements sont identiques. Ils ne produisent pas la même tension, n’offrent pas la même profondeur, ne convoquent pas la même mémoire.
Alors, comment choisir ? Et surtout : pourquoi ce choix compte-t-il autant ?

Le temps du roman : une affaire de regard
Écrire, c’est toujours regarder le monde depuis un point précis. Le temps verbal est ce point d’observation invisible mais décisif. Il indique d’où l’on parle.
Le passé installe une distance. Quelqu’un raconte ce qui a eu lieu. Les événements sont achevés, même s’ils vibrent encore. Le narrateur sait, ou semble savoir, ce qui est arrivé après. Il peut trier, hiérarchiser, interpréter. Le récit devient mémoire, reconstruction, parfois confession.
Le présent, au contraire, nie cette distance. Il donne l’illusion que l’histoire se déroule sous nos yeux. Le narrateur ne sait pas ce qui va suivre, ou fait semblant de ne pas le savoir. Le texte avance à hauteur d’instant. Le lecteur marche au même rythme que le personnage.
Ce simple déplacement du regard transforme tout : le suspense, l’émotion, la crédibilité même du récit.
Écrire au passé : la profondeur de la mémoire
Le passé est le temps le plus ancien du roman. Il porte avec lui une tradition séculaire. De Balzac à Tolstoï, de Flaubert à Yourcenar, il a façonné notre idée même de la littérature.
Écrire au passé, c’est accepter que l’histoire soit déjà arrivée. Et paradoxalement, c’est ce qui permet souvent la plus grande intensité émotionnelle.
Parce que le passé autorise le recul. Il permet l’analyse, l’ironie, la nuance. Un narrateur au passé peut dire : à ce moment-là, je ne savais pas encore… Il peut faire sentir le poids du destin, la fatalité, l’erreur rétrospectivement lisible.
Le passé est aussi le temps du sens. Les événements ne sont pas seulement vécus, ils sont compris. Même lorsque le narrateur est naïf ou peu fiable, le simple fait qu’il raconte après coup donne au texte une épaisseur réflexive.
C’est un temps particulièrement puissant pour :
- les romans psychologiques,
- les sagas familiales,
- les récits initiatiques,
- les histoires où la transformation intérieure est centrale.
Le passé épouse naturellement la structure du roman classique : un début, un développement, une fin. Il rassure le lecteur, lui donne le sentiment d’un monde maîtrisé, construit.
Mais cette force peut devenir une faiblesse.
Les pièges du passé
Écrire au passé peut parfois émousser la tension. Puisque tout est déjà arrivé, le danger semble moins immédiat. Le lecteur sait, inconsciemment, que quelqu’un est là pour raconter, donc qu’il a survécu, au moins jusqu’à la dernière page.
Le passé peut aussi favoriser une écriture trop explicative. Le narrateur analyse, commente, justifie. Il dit plus qu’il ne montre. Le roman se met à expliquer ce que le lecteur pourrait ressentir seul.
Enfin, le passé demande une grande rigueur stylistique. Mal maîtrisé, il alourdit la phrase, multiplie les constructions complexes, installe une solennité involontaire.
Choisir le passé, ce n’est pas choisir la facilité. C’est accepter un art du dosage, de la retenue.
Écrire au présent : l’urgence et la proximité
Depuis plusieurs décennies, le présent s’est imposé dans la littérature contemporaine. Il séduit par son énergie, sa nervosité, son impression d’immédiateté.
Écrire au présent, c’est plonger le lecteur dans l’action. Tout arrive maintenant. Chaque geste compte. Chaque décision semble irréversible.
Le présent crée une proximité presque physique avec les personnages. Le lecteur n’est plus en train d’écouter une histoire, il la vit. Il partage l’ignorance, la peur, l’élan. Il ne sait pas plus que le personnage ce qui l’attend à la page suivante.
Ce temps est particulièrement efficace pour :
- les thrillers,
- les romans d’action,
- les récits introspectifs,
- les textes centrés sur la perception et les sensations.
Le présent épouse notre manière moderne de consommer les récits : rapide, immersive, fragmentée. Il donne au roman une pulsation presque cinématographique.
Mais cette intensité a un prix.
Les limites du présent
Le présent est un temps exigeant. Il supporte mal la longueur. Sur plusieurs centaines de pages, il peut fatiguer, créer une tension constante qui ne retombe jamais, au risque de l’épuisement émotionnel.
Il complique aussi la profondeur temporelle. Comment évoquer le passé d’un personnage sans casser le rythme ? Comment inscrire une histoire dans une durée longue sans recourir à des artifices ?
Le présent peut enfin produire une illusion dangereuse : celle de la facilité. Parce qu’il semble plus naturel, plus oral, certains textes se contentent d’une écriture plate, descriptive, sans véritable travail stylistique.
Un roman au présent raté donne souvent l’impression d’un brouillon prolongé, d’un flux non maîtrisé.
Présent ou passé : une question de voix, pas de mode
Le véritable critère n’est ni la modernité ni la tradition. Ce n’est pas non plus le genre littéraire, même si certains temps y sont plus fréquents.
La vraie question est celle de la voix.
Qui parle ?
Un personnage qui raconte pour comprendre ? Le passé s’impose.
Un personnage qui traverse une épreuve sans recul ? Le présent devient évident.
Certains romans échouent parce qu’ils ont choisi un temps « à la mode » plutôt que le temps juste. On sent alors un décalage, une voix qui force, un récit qui sonne faux.
Le bon temps verbal est celui qui disparaît à la lecture. Celui dont on ne se rend plus compte. Celui qui laisse la place à l’histoire.
Peut-on mêler présent et passé ?
Oui ; mais avec une extrême vigilance.
Alterner les temps peut enrichir un roman, créer des effets de contraste, matérialiser différentes strates de conscience. Un présent pour l’action, un passé pour la mémoire. Un présent pour l’urgence, un passé pour la réflexion.
Mais ce choix doit être pensé dès le départ. Les ruptures temporelles gratuites désorientent le lecteur. Elles donnent l’impression d’un manque de maîtrise, d’une hésitation non assumée.
Changer de temps, c’est changer de pacte narratif. Cela doit avoir un sens profond, lisible, presque organique.
Et si le vrai dilemme était ailleurs ?
Présent ou passé : la question fascine parce qu’elle est visible. Mais elle masque parfois un enjeu plus essentiel : celui de la justesse.
Un roman mal écrit au présent restera un mauvais roman. Un roman puissant au passé traversera les époques. Le temps verbal n’est pas une recette, ni une garantie.
Ce qui compte, c’est la cohérence entre :
- la voix narrative,
- la matière du récit,
- l’expérience émotionnelle proposée au lecteur.
Certains auteurs trouvent leur voix au présent, d’autres au passé. Beaucoup tâtonnent, réécrivent, changent en cours de route, parfois au prix de révisions titanesques.
Ce travail fait partie du roman.
Choisir, c’est renoncer
Choisir un temps, c’est accepter de perdre autre chose. Le présent renonce à la sagesse du recul. Le passé renonce à l’adrénaline de l’instant.
Mais c’est précisément ce renoncement qui donne au texte sa force. Un roman indécis sur son temps est souvent un roman indécis sur sa voix.
Avant de trancher, il faut écouter son texte. Lire à voix haute. Ressentir le rythme. Observer où la phrase respire, où elle résiste.
Et parfois, il faut accepter une vérité dérangeante : ce roman que l’on croyait devoir écrire au présent réclame le passé. Ou l’inverse.
Le dilemme n’est pas un obstacle. Il est un passage.
Car au fond, écrire, c’est toujours choisir un temps pour dire le monde, et accepter que ce temps nous transforme, nous aussi.