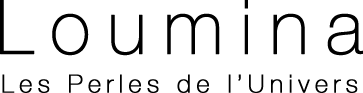La « correction selon les règles de l’art » ne se limite pas à traquer les fautes d’orthographe. C’est un soin global porté au texte pour qu’il soit lisible, cohérent, homogène et crédible, quel que soit le support (livre, article scientifique, site web, brochure). Ce guide vous propose un panorama opérationnel : ce que cela implique, les normes usuelles, des règles concrètes et une check-list prête à l’emploi.
Correction selon les règles de l’art : typographie, style et cohérence

1) Ce que recouvre une correction « règles de l’art »
La correction éditoriale ne se limite pas à chasser les fautes d’orthographe : elle englobe l’ensemble des ajustements linguistiques, typographiques et structurels qui garantissent la qualité et la lisibilité d’un texte. Ce premier point définit les différents niveaux de correction et leur rôle :
- Langue : orthographe, grammaire, concordance des temps, syntaxe.
- Typographie & ponctuation : guillemets, espaces, tirets, capitales, abréviations.
- Cohérence & vraisemblance : renvois à figures/tableaux, dates, noms propres, unités, données chiffrées.
- Normalisation éditoriale : hiérarchie des titres, bibliographie/références, notes, tableaux, style maison.
Dans la pratique, on distingue souvent :
- Relecture (proofreading) : dernière passe pour coquilles, espaces, sauts de ligne, ponctuation.
- Révision/copy-editing : harmonisation du style, de la terminologie, de la structure, des références.
- Édition de fond (substantive editing) : restructuration, clarifications, suggestions d’ajouts ou de coupes.
2) Principales normes et cadres de référence
Pour corriger avec rigueur, il est indispensable de s’appuyer sur des cadres normatifs établis. Qu’il soit question de typographie française, de conventions internationales ou de chartes éditoriales propres à une maison, ces références définissent la cohérence à suivre.
- Typographie française : Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale (souvent appelé « Lexique »), usages AFNOR.
- Références bibliographiques : ISO 690 (international), APA (sciences humaines et sociales), MLA (littérature), Chicago (Notes & Bibliography ou Author-Date), Vancouver (médecine).
- Chartes éditoriales internes : chaque maison/média peut préciser ses préférences (guillemets, capitales, style des titres, etc.). La cohérence prime : on choisit un système, on s’y tient.
3) Typographie et ponctuation fine (français)
La typographie est la base de la correction professionnelle : elle influe directement sur le confort de lecture et la crédibilité du texte. Ce paragraphe rappelle les règles essentielles en matière de guillemets, espaces, tirets, abréviations et signes diacritiques.
Guillemets et espaces
- En français, on privilégie les guillemets « … » avec espace fine insécable à l’intérieur :
« citation » (et non "citation"), sauf charte contraire ou public international. - Les guillemets anglais (“…”) peuvent être employés à l’intérieur d’une citation déjà entre guillemets français.
Espaces insécables
- Avant ; : ? ! % » et après « : utiliser une espace insécable (souvent « fine insécable » en composition pro) pour éviter la coupure en fin de ligne.
Ex. : Attention : ceci est important ! 20 % des… - Entre le nombre et l’unité : 5 km, 30 °C, 1 000 000 (espaces fines insécables comme séparateurs de milliers en français).
- Pas d’espace avant la virgule ou le point ; une espace après.
Tirets, traits d’union, intervalles
- Trait d’union - : mots composés (avant-propos, porte-monnaie).
- Tiret d’incise : cadratin — ou demi-cadratin – selon la charte : — comme ceci — sans coller au mot (espaces fines non insécables selon réglages, mais cohérence avant tout).
- Intervalles (périodes, plages) : 1914–1918, pp. 45–52 avec tiret moyen (–) sans espaces autour.
Apostrophe, points de suspension, ellipses
- Apostrophe typographique ’ (et non l’apostrophe droite ').
- Points de suspension : le caractère unique … (pas trois points séparés), collés au mot précédent ; espace après si le texte continue.
Abréviations, sigles, capitales
- Abréviations : M. (Monsieur), Mme (Madame), Dr, cf., etc. (avec point final), p. (page), pp. (pages). Cohérence sur l’italique pour cf..
- Sigles : en petites capitales si la charte le permet (OTAN), sinon capitales normales (ONU). On peut développer à la première occurrence : Organisation des Nations unies (ONU).
- Capitales : sobres et motivées : « l’État » (institution) / « l’état » (situation). Mois et jours en minuscules en français : mardi 2 septembre 2025.
4) Hiérarchie des titres et architecture du texte
Une structure claire et hiérarchisée facilite la compréhension du lecteur et reflète le sérieux de la publication. Ce point détaille les principes de numérotation, de style des titres et de cohérence entre le texte et la table des matières.
- Progression logique : pas de saut de H2 à H4. Une arborescence claire : 1, 1.1, 1.2, 2, etc., si numérotation retenue.
- Style des titres :
- Style phrase : seule la première lettre est en capitale (La cohérence des titres).
- Style titre : capitales aux mots significatifs (La Cohérence des Titres) — à définir en charte.
- Ponctuation : uniformiser (titres sans point final, par exemple, sur tout l’ouvrage).
- Table des matières : alignée avec les titres réels, niveaux cohérents, numéros de pages à jour.
5) Références, notes, bibliographies : principes et exemples
La présentation des références bibliographiques est l’un des aspects les plus normés de l’édition. Ce paragraphe explique comment choisir un style (APA, Chicago, ISO, etc.) et l’appliquer avec constance, en donnant des exemples concrets.
Règles générales
- Choisir un style (APA, Chicago, ISO 690, etc.) et l’appliquer partout.
- Ordre, ponctuation, italique : uniformes.
- Titres d’ouvrages/revues souvent en italique ; titres d’articles en roman entre guillemets (selon style).
- DOI/URL : format cohérent, date de consultation si requis.
- Harmonie entre citations dans le texte et entrées de bibliographie.
Trois styles bibliographiques courants : APA, Chicago et ISO 690
Les références bibliographiques sont essentielles pour assurer la rigueur scientifique d’un texte et permettre au lecteur de retrouver facilement les sources citées. Selon la discipline et le pays, plusieurs styles coexistent. Voici un aperçu détaillé de trois systèmes parmi les plus utilisés.
1. APA (American Psychological Association – système auteur-date)
Très répandu dans les sciences sociales, la psychologie, l’éducation et la sociologie. En France, il est de plus en plus utilisé à l’université, notamment dans les mémoires et thèses.
- Dans le texte : on cite l’auteur, l’année et éventuellement la page.
Exemple :- (Durand, 2020, p. 45)
- (Dupont & Martin, 2019)
- (Martin et al., 2021)
- En bibliographie :
Durand, J. (2020). La mémoire collective. Paris : PUF.
Dupont, A., & Martin, S. (2019). Sociologie du quotidien. Lyon : ENS Éditions.
Martin, L., Petit, C., & Roger, N. (2021). Psychologie sociale appliquée. Marseille : Solal.
L’APA se distingue par l’usage intensif des parenthèses dans le texte et une bibliographie très normée (italiques pour les titres, majuscules limitées, mise en évidence de l’année).
2. Chicago (Notes and Bibliography)
Très courant en histoire, littérature et sciences humaines. Il est apprécié pour sa clarté et son élégance, mais demande une gestion rigoureuse des notes de bas de page.
- Dans le texte (système notes) :
- “Jean Durand, La mémoire collective (Paris : PUF, 2020), 45.“
- “André Dupont et Sophie Martin, Sociologie du quotidien (Lyon : ENS Éditions, 2019), 123.“
- En bibliographie :
Durand, Jean. La mémoire collective. Paris : PUF, 2020.
Dupont, André, et Sophie Martin. Sociologie du quotidien. Lyon : ENS Éditions, 2019.
Le système Chicago existe aussi en version Auteur-Date, mais c’est le modèle Notes et Bibliographie qui domine dans les sciences humaines.
3. ISO 690 (Norme internationale)
C’est la norme ISO (690:2010) qui propose un cadre universel de présentation des références. En France, c’est souvent la norme officielle conseillée par les bibliothèques universitaires. Elle est plus sobre et systématique, mais parfois jugée un peu rigide.
- Exemple pour un ouvrage :
DURAND, Jean. La mémoire collective. Paris : PUF, 2020. ISBN 978-2-13-045678-9. - Exemple pour un article de revue :
DUPONT, André et MARTIN, Sophie. “La vie quotidienne revisitée”. Revue française de sociologie, 2019, vol. 60, n° 3, p. 123-140. DOI 10.3917/rfs.603.0123. - Exemple pour une ressource en ligne :
PETIT, Claire. Introduction à la psychologie sociale. En ligne. Paris : Université de Paris, 2021. [Consulté le 2 septembre 2025]. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03223321.
Quel style privilégier en France ?
- Dans les sciences sociales et humaines → l’APA est de plus en plus demandé, surtout dans les mémoires, thèses et articles académiques.
- Dans les sciences historiques, littéraires ou philosophiques → le style Chicago (notes) reste très apprécié, car il met en avant les références en bas de page.
- Pour des travaux académiques institutionnels ou officiels en France → l’ISO 690 est la norme de référence (souvent recommandée par les bibliothèques universitaires, comme l’ABES ou certaines BU).
👉 En résumé :
- Le plus utilisé en France dans l’enseignement supérieur aujourd’hui = APA.
- Le plus traditionnel en sciences humaines/histoire = Chicago (notes).
- Le plus neutre et institutionnel = ISO 690.
Astuce : constituer un modèle de notice par type de source (livre, chapitre, article, site web, thèse) et s’y tenir.
6) Cohérence interne du texte
La correction consiste aussi à vérifier que l’ensemble du document “tient debout” : figures bien numérotées, légendes uniformes, unités normalisées, dates cohérentes et orthographe stable des noms propres. L’objectif est d’éviter toute contradiction interne.
Renvois et numérotations
- Figures, tableaux, annexes : numérotation unique et appelée dans le texte : voir figure 2, tableau 3. Harmoniser le libellé (Figure vs Fig.).
- Légendes : style constant : Figure 2 — Titre de la figure.
- Notes : renumérotation automatique, ordre cohérent, ponctuation uniforme.
Unités, dates, nombres
- SI : espace entre nombre et symbole : 10 kg, 25 mm, 3 h.
- Angles, température : 30 °C, 45° (selon cas).
- Litre : L (majuscule recommandée).
- Décimales : virgule en français (3,14) ; séparation des milliers par espace fine (12 500).
- Dates : 2 septembre 2025 (jour en chiffres, mois en lettres, sans zéro initial), format cohérent partout.
Noms propres et terminologie
- Graphie stable des noms (Tolstoï/Tolstoy : faire un choix, s’y tenir).
- Translittérations : lorsqu’on retranscrit des noms issus d’alphabets non latins (russe, arabe, chinois, etc.), il est préférable de choisir un système reconnu (ISO, BGN/PCGN, pinyin, Hepburn…) et de s’y tenir, afin d’éviter que le même nom apparaisse sous plusieurs formes différentes dans le texte.
- Glossaire pour termes techniques, acronymes et variantes.
7) Consistance stylistique
Au-delà des règles techniques, le texte doit adopter un ton et un style homogènes. Ce point aborde l’uniformité dans l’usage des temps, des majuscules, des abréviations, de l’italique et des listes, afin d’offrir une expérience de lecture fluide.
- Ton et registre : choisir (académique, journalistique, grand public) et l’appliquer.
- Personnes/temps : éviter les bascules injustifiées (nous/je, passé/présent).
- Italique : pour titres d’œuvres, mots étrangers non francisés (leitmotiv peut rester romain si passé dans l’usage selon la charte).
- Abréviations : uniformiser (par ex. ou p. ex., mais pas les deux).
- Listes : cohérence de la ponctuation finale (toutes les puces sans point ou toutes avec point-virgule, etc.).
- Citations : style constant (longues citations en retrait, corps réduit, sans guillemets si retrait, selon charte).
8) Présentation éditoriale (mise en forme)
La mise en forme est le prolongement naturel de la correction. Elle garantit la lisibilité visuelle du texte, tant dans une maquette imprimée que dans une version numérique. Ce paragraphe présente les grands principes de styles, polices, marges et accessibilité.
- Styles de paragraphe : utiliser des styles (Titre 1, Corps, Légende) plutôt que formatages locaux.
- Polices et corps : un couple principal (texte/titres), tailles harmonisées, interlignage constant.
- Marges, césures, veuves et orphelines : contrôler les sauts de page, éviter les lignes uniques en haut/bas de page.
- Table des matières/index : générés automatiquement depuis les styles, mis à jour en fin de chaîne.
- Accessibilité web (si support numérique) : titres balisés h1–h6, listes
<ul>/<ol>, textes alternatifs pour images, contrastes suffisants.
9) Méthode de travail : du brouillon au bon à tirer
La correction professionnelle suit un processus méthodique, en plusieurs passes successives. Ce paragraphe décrit les étapes clés, de la définition d’une charte jusqu’à la validation finale du Bon à tirer (BAT).
- Définir la charte : guillemets, capitales, style de références, traitements spéciaux (anglicismes, chiffres, unités).
- Première passe (fond) : structure, répétitions, lourdeurs, logique des sections.
- Deuxième passe (forme) : typographie, ponctuation, listes, tableaux, légendes.
- Troisième passe (références) : aligner citations et bibliographie, normaliser.
- Pré-BAT : contrôle de maquette, retours d’automatisation (TOC, index), veuves/orphelines, images en résolutions suffisantes, profils colorimétriques si impression.
- BAT : dernière relecture croisée (une personne lit à voix haute, une autre suit le texte), validation.
10) Outils utiles (à paramétrer selon la charte)
Pour gagner en efficacité, les correcteurs disposent d’outils spécialisés : correcteurs orthographiques, logiciels de gestion bibliographique, fonctions avancées des traitements de texte et moteurs de recherche par expressions régulières.
- Correcteurs : Antidote, Grammalecte (LibreOffice), LanguageTool.
- Gestion bibliographique : Zotero, EndNote, Mendeley (styles personnalisés CSL).
- Traitement de texte & PAO : Word/Writer (styles), InDesign (feuilles de style, GREP), Markdown → Pandoc (chaîne éditoriale reproductible).
- Recherches GREP/Regex : pour repérer espaces insécables manquantes, doubles espaces, citations incohérentes.
11) Erreurs fréquentes à traquer
Certaines erreurs reviennent de manière récurrente dans les manuscrits et doivent être repérées en priorité. Ce paragraphe dresse une liste des pièges typographiques et éditoriaux les plus courants.
- Guillemets mélangés (" " et « ») dans le même document.
- Espaces insécables manquantes avant ; : ? ! % et autour de « ».
- Intervalles avec tiret court (-) au lieu du tiret moyen (–).
- Mélange de formats de dates (02/09/25 et 2 septembre 2025).
- Bibliographie hétérogène (ordre, ponctuation, italique, capitales).
- Unités collées au nombre (5km au lieu de 5 km).
- Numérotation des figures/tableaux non appelée dans le texte.
- Incohérences de capitales (révolution française / Révolution française).
- Listes où la ponctuation varie d’une puce à l’autre.
- Références citées mais absentes de la bibliographie (et inversement).
12) Mini feuille de style (modèle prêt à adapter)
La meilleure façon d’assurer une correction homogène est de disposer d’une feuille de style claire. Ce modèle propose des règles concrètes et facilement adaptables aux besoins de chaque projet éditorial.
Guillemets : français « … ». Guillemets anglais “…” pour citation dans la citation.
Espaces : insécables avant ; : ? ! % » et après «. Nombre + unité : espace insécable (ex. : 5 km).
Tirets : intervalles – sans espaces (1914–1918). Incises — mot — (cadratin).
Chiffres : séparateurs de milliers : espace fine (12 500). Décimales : virgule (3,14).
Dates : 2 septembre 2025.
Titres : style phrase, sans point final. Hiérarchie H1 > H2 > H3.
Italique : titres d’ouvrages/revues ; mots étrangers non francisés.
Références : style APA. Titre d’ouvrage en italique ; DOI quand disponible.
Figures/Tableaux : Figure 1 — … / Tableau 1 — …. Appel obligatoire dans le texte.
Abréviations : cf. en italique ; etc. en romain ; par ex. uniforme.
Notes : numérotation automatique, point final si phrase complète.
13) Tableau récapitulatif (mémo)
Pour disposer d’une vue d’ensemble, ce tableau synthétise les règles principales par domaine. C’est un outil pratique de vérification rapide en cours de correction.
| Domaine | Règle clef | Exemple |
|---|---|---|
| Guillemets | Français avec espaces fines insécables | « citation » |
| Espaces | Insécable avant ; : ? ! % | Attention : c’est fait ! |
| Unités | Espace insécable entre nombre et symbole | 20 km, 30 °C |
| Intervalles | Tiret moyen sans espaces | pp. 15–23 |
| Titres | Style phrase, sans point final | La cohérence des titres |
| Dates | Jour en chiffres, mois en lettres | 2 septembre 2025 |
| Références | Style unique (APA/Chicago/ISO) | (Durand, 2020) |
| Figures | Légende uniforme et appel dans le texte | Figure 2 — Localisation |
14) Bonnes pratiques éditoriales
La correction ne se résume pas à l’application mécanique de règles : elle suppose aussi une méthode de travail efficace et collaborative. Ce paragraphe propose des conseils concrets pour gagner en rigueur et en fluidité.
- Documenter tes choix dans une feuille de style partagée ; la mettre à jour au fil du projet.
- Automatiser ce qui peut l’être (styles, TOC, références) ; réserver l’humain à l’arbitrage et au sens.
- Relire à voix haute pour repérer ruptures de rythme et ambiguïtés.
- Comparer deux versions avec un outil de suivi des modifications (commentaires, propositions).
- Laisser reposer le texte avant la dernière passe : l’œil frais voit mieux.
15) Conclusion
Corriger selon les normes éditoriales, c’est mettre le texte au carré, depuis l’accent oublié jusqu’à la bibliographie capricieuse. Les bénéfices sont concrets : crédibilité, confort de lecture, repérabilité (métadonnées propres), réutilisabilité (chaînes de production fluides). Choisissez un cadre (Lexique, APA/Chicago/ISO 690, charte maison), appliquez-le avec constance, et équipez-vous d’une feuille de style vivante. Le lecteur ne remarquera peut-être pas cet artisanat discret — c’est même le signe qu’il est réussi.